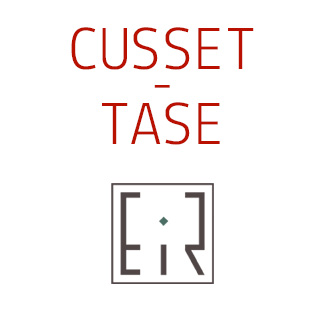Les prémices de L’EIR Cusset-TASE (1815-1924)
« Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n’est plus ».
C’est avec ces mots que le conventionnel Bertrand Barrère clôture quatre mois de siège de Lyon orchestré par les Montagnards parisiens à l’encontre des Girondins à la tête de la municipalité lyonnaise. Nous sommes en octobre 1793, et la Convention Nationale décrète que la ville de Lyon s’efface du tableau des villes de la République et qu’elle porte désormais le nom de « Ville-Affranchie ».
En août 1794, Robespierre, chef de file des Montagnards, meurt à Paris. Sa chute entraîne avec lui celle de la Convention qui n’a plus le contrôle du pouvoir. La période révolutionnaire fait de Lyon une ville meurtrie, ruinée et dépeuplée. La noblesse fortunée, qui représentait la majeure partie de la clientèle de la Fabrique, a fui la ville. Cent quinze des quatre cents entrepreneurs en soierie partent et de nombreux maîtres soyeux avec eux.
De 1793 à 1800, la population passe de 150 000 personnes à 88 000. Après la Révolution, le Premier Empire et Napoléon 1er, conscients du potentiel économique de la soie, relancent cette industrie avec notamment de très importantes commandes destinées aux Palais impériaux comme Fontainebleau ou Versailles (tissus d’ameublement pour tenture et pour recouvrir le mobilier).
Le soutien à la soie apporté par le pouvoir d’alors sera constant, le pouvoir cherchant à inciter les élites officielles à se vêtir de soie. Grâce à ce soutien décisif, la production d’étoffes de soie, en 1815, retrouve son niveau d’avant la Révolution. La ville se relève démographiquement et économiquement et voit, tout au long du XIXe siècle, se créer les conditions de sa Révolution industrielle.
Les prémices de L’EIR Cusset-TASE (1815-1924)
Le Rhône : du fleuve divaguant au fleuve canalisé et aménagé
Un fleuve impétueux
De l'an mil à la fin du XVIIIe siècle : un fleuve alternant et capricieux
Le Rhône paisible | De l’an mille jusqu’au XIVe siècle, le Rhône déroule paisiblement ses méandres le long des Balmes Viennoises : coteau naturel d’une hauteur de douze à quinze mètres, formant l’ancienne rive gauche du Rhône à l’époque où celui-ci s’étalait dans toute la plaine. Il emprunte l’itinéraire actuel du canal de Jonage. Le Rhône, peu menaçant, voit des villages comme ceux de Niévroz, Thil et Vaulx-en-Velin s’installer à proximité du fleuve.
Un fleuve de plus en plus instable | A partir du XIVe siècle et ce, jusqu’au XVIIIe siècle, le fleuve gagne en instabilité et se déplace progressivement de deux à trois kilomètres vers le nord. C’est une manifestation d’un bouleversement hydro-climatique qui s’amorce dès le début du XIVe siècle concordant à l’aire du Petit Âge Glaciaire. Le fleuve adopte un tracé en tresses et les méandres du chenal principal (Grand-Rhône) se séparent et se réunissent fréquemment au gré de crues très marquées. De part et d’autre de son chenal principal, de nombreux chenaux forment une multitude d’îles, de bancs de galets et de brotteaux.
A la fin du XVIIIe siècle, le Rhône retourne au centre de la plaine, à l’emplacement du Vieux-Rhône. Impuissant à contenir les eaux, les riverains se disputent âprement la propriété des terres vagabondes. À cette époque la puissance du Rhône n’est pas encore valorisée. L’énergie du fleuve est seulement utilisée par quelques moulins qui utilisent l’écoulement provenant du sous-sol ou des collines pour produire la force motrice nécessaire à la mouture des grains.
Le Rhône, une entrave au développement économique du secteur lyonnais
Depuis l’installation des Hommes le long du Rhône, on dénote des dizaines de crues, parfois terriblement dévastatrices. En 1711, le Rhône et la Saône mêlent leurs eaux sur la place Bellecour, causant des désastres immenses aux constructions de la presqu’île. La crue de novembre 1840 est provoquée par une succession d’averses méditerranéennes torrentielles (quatre au total), dont une au moins accompagnée de pluies océaniques diluviennes. C’est l’événement météorologique le plus grandiose et le plus déconcertant qui se soit jamais produit dans le bassin du Rhône, selon le géographe Maurice Pardé. La crue est très forte en amont de Lyon et exceptionnelle en aval à cause des apports de la Saône.
À Lyon, pendant tout le mois de novembre, le centre de la ville et une partie de Vaise sont sous les eaux ; six cents maisons s’écroulent. En 1856, Lyon connaît une nouvelle catastrophe d’une ampleur considérable. En effet, le 31 mai, après un mois de précipitations anormalement élevées, la digue du Rhône cède sur cent cinquante mètres. Des tonnes d’eau déferlent sur la rive gauche vers Villeurbanne, les Charpennes et la Guillotière. Les dégâts sont considérables. Les maisons détruites se comptent par dizaines. Dix-huit morts, officiellement, sont relevés. Des milliers de sans-abri trouvent refuge dans les églises et les casernes.
Au cours de ces divagations, entre les Balmes viennoises au Sud et la Côtière au Nord, le Rhône a fini par créer, au XIXe siècle, un vaste delta de 15 km de long et 4 km de large, parsemé d’îles et de canaux. Trop instable, les bateaux peinent à s’y aventurer : il empêche la population du secteur lyonnais de pleinement se développer. En plus d’être dévastateur pour les constructions en ville, le fleuve sauvage détruit régulièrement des champs entiers, privant de ressources les paysans du secteur.
À la moitié du XIXe siècle, il est urgent de canaliser ce cours d’eau instable. Investisseurs, ingénieurs et ouvriers ne s’y trompent pas et portent un coup fatal à la suprématie du fleuve divaguant.
Le creusement du canal de Miribel
De grands travaux portés par les ateliers nationaux
C’est à la suite de graves inondations en 1840 qu’il est décidé de la « correction » du fleuve. Afin de faciliter la navigation, d’arrêter les inondations et de favoriser le développement de l’agglomération lyonnaise en rive gauche, des ingénieurs du « Service spécial du Rhône » vont imaginer un canal de dérivation du Rhône : le canal de Miribel.
Ce sont les mesures prises après la révolution de février 1848 (création des Ateliers nationaux pour occuper les ouvriers sans travail) qui motivent le démarrage réel des travaux du canal de Miribel. Son creusement dure neuf années, de 1848 à 1857, et mobilise la force de 500 hommes. Les Ateliers nationaux sont créés pour permettre aux chômeurs parisiens de trouver un emploi à la suite de la révolution de février 1848.
C’est le gouvernement provisoire qui crée ces fameux Ateliers caractérisés par le fait que l’État fournit, organise et paie le travail. Cette « expérience » sociale a duré à peine trois mois (de mars à juin 1848). Malgré sa courte existence, les Ateliers nationaux ont permis d’attirer en nombre de la main-d’œuvre qui se fixe durablement sur le chantier du canal.
Son tracé emprunte le chenal qui est à l’époque le plus au nord. Une plaine alluviale (forme de plaine caractérisée par une surface topographique plane avec de très faibles pentes) entre Miribel et Jonage est aménagée. Elle est chargée d’étaler les eaux issues des crues en offrant au fleuve un vase d’expansion pour ses eaux débordantes.

Le creusement du canal de Miribel dans le lit du Rhône permet de maîtriser les crues et de faciliter la circulation des bateaux de grand gabarit pour le transport du bois et de la pierre, ainsi que celle des lignes reliant Lyon à Aix-les-Bains sur des bateaux propulsés par des roues à aubes qui emmenaient dans les 15 000 voyageurs en 1845.
Le problème des inondations n’est que partiellement réglé, alors que celui de la navigation l’est totalement.
L’industrie lyonnaise se développe à la fin du XIXe siècle et tente de se moderniser par le biais de la mécanisation. Les besoins en énergie abondante et bon marché se font alors ressentir.
À la toute fin du XIXe siècle, on pense à un nouvel aménagement capable de transformer la force du fleuve en énergie électrique et de fournir ainsi en électricité les entreprises qui en ont besoin.
Canal de Jonage et usine de Cusset :
un aménagement colossal au service de l’industrie du secteur lyonnais
Création de la Société lyonnaise des forces motrices du Rhône
En pleine crise économique, la relative pénurie et le coût élevé du charbon pénalisent l’industrie lyonnaise dans sa modernisation et son développement. Un ingénieur, Jean-François Raclet, présente un projet de dérivation du Rhône en 1886 dans le but de produire de l’électricité : un canal entre Jons et Lyon. L’est lyonnais présente de nombreux atouts : ces terres, encore soumises aux inondations, demeurent largement inhabitées. L’ingénieur rencontre un riche fabricant nommé Joseph-Alphonse Henry, un homme influent dans l’univers du textile et des affaires.
Monsieur Henry et ses connaissances permettent au Syndicat lyonnais des forces motrices du Rhône en charge du projet d’obtenir de précieux soutiens financiers. Grâce à l’intervention décisive d’intérêts parisiens, le Syndicat obtient par une convention provisoire une concession avec déclaration d’utilité publique d’une durée de 99 ans et un triple objectif : production d’électricité, amélioration de la navigation et fourniture d’eau. En 1893, la Société lyonnaise des forces motrices du Rhône se substitue au Syndicat (SLFMR).
Ce projet ambitieux – construction de la plus puissante centrale hydroélectrique de France – répond à une stratégie commerciale nouvelle : s’installer directement sur un marché urbain vaste et diversifié. Les travaux débutent en 1894 sous la direction d’Abel Gotteland, ingénieur-conseil du chantier, diplômé de l’Ecole d’application des Ponts et Chaussés. Ce chantier est pratiquement équivalent, en termes de moyens financiers, à celui du tunnel sous la Manche.
Un chantier colossal : le machinisme comme substitution de la main d’œuvre
Compte tenu de la nature des travaux à effectuer, le machinisme, c’est-à-dire l’emploi généralisé des machines substituées à la main-d’œuvre, joue un rôle fondamental. Pour le creusement du canal, est utilisé sur terre sept excavateurs : des engins munis d’une chaîne à godet. Sur l’eau, sont utilisées des dragues, des bateaux munis d’une chaîne à godets ou d’un système à succion.
Pour le transport des déblais liés au creusement du canal, on utilise sur terre vingt-cinq locomotives à vapeur, cinquante-six kilomètres de voies, plus de cinq cents wagons et wagonnets et une grue élévateur mobile sur rails. Pour le transport fluvial, on utilise des toueurs (bateau remorqueur se déplaçant par traction sur une chaîne) et des chalands (bateau de transport à fond plat). Pour le « tassement » des digues, on utilise deux rouleaux à vapeur aux roues cannelées, deux « piétineuses » conçues spécialement pour le chantier du canal de Jonage, treize locomobiles (machine à vapeur sur roues) et neuf pompes centrifuges.
Le matériel employé sur ce chantier provient souvent des ateliers lyonnais et ont déjà été à l’œuvre pour le creusement du canal de Suez (1869) ou encore celui de Panama (1880). On estime à trois mille le nombre de personnes employées sur ce chantier, souvent dangereux, et pour la plupart logées dans des cabanes en bois.
Le canal et ses équipements
Le creusement du canal de Jonage à un quadruple objectif : produire de l’électricité, améliorer la navigation, fournir de l’eau à la ville de Lyon et ses industries et stopper les inondations.
Le canal, d’une longueur de 18,850 km, est équipé, à la fin des travaux en 1899, d’un ouvrage de garde (barrage de Jonage), d’un déversoir (déversoir d’Herbens), d’un bassin compensateur et d’une usine-barrage (usine hydroélectrique de Cusset). Ces équipements évoluent au fil du temps afin de maximaliser la production d’électricité.
Le barrage de Jonage | Le barrage de Jonage, aussi appelé « ouvrage de garde », fut imposé par l’Etat aux concessionnaires. La SLFMR était d’abord réticente à l’idée de construire un barrage en amont de l’usine hydro-électrique de Cusset. Elle y trouva finalement son intérêt car ce dernier permettait de protéger l’usine d’une arrivée massive d’eau en assurant la prise d’eau et le contrôle du débit.
Il faisait également office de réservoir de décantation limitant l’introduction dans le canal du sable et des graviers charriés en abondance par le Rhône. Ces corps flottants ne pouvaient donc atteindre l’usine de Cusset et menacer ses turbines. Peu après sa mise en service, le barrage subit de graves avaries lors d’une crue du Rhône en avril 1899. Il est reconstruit en 1901 en étant plus à même de résister aux crues.
Après la construction du barrage de Jons en 1937 qui assure la régulation du débit d’entrée dans le canal, le barrage de Jonage est maintenu par simple mesure de sécurité.

Déversoir d’Herbens | Recommandé par les ingénieurs des Ponts et Chaussés, le déversoir permet d’évacuer un trop-plein éventuel dû à un accident ou à une fausse manœuvre au barrage de Jonage. Il a été construit pour protéger la digue d’un éventuel débordement qui aurait pu être causé par un trop-plein ou par une vague d’eau remontant de Cusset suite à un arrêt brutale de la centrale. Jusqu’en 2007 et l’installation d’un déchargeur à l’usine de Cusset, le déversoir d’Herbens jouait un rôle primordial.

Bassin compensateur (réservoir du Grand Large) | Un infléchissement naturel des Balmes Viennoises a permis de constituer, à bon compte, un vaste étendue d’eau à la fois sur les communes de Meyzieu et de Décines. Ce réservoir sert à réguler les eaux à l’approche de l’usine de Cusset lui assurant une protection supplémentaire contre une irruption d’eau accidentelle et massive.
Il permet également d’augmenter ponctuellement la production en réalisant des éclusées. Ces éclusées consistent à lâcher, lors des heures de pointes de consommation d’électricité (matin ou soir), l’eau stockée dans ce bassin, augmentant de la sorte le débit turbiné. Enfin, il fait office de bassin de décantation pour les eaux du Rhône dont le limon reste en expansion. Avec l’abandon du système des éclusées en 1930, le Grand Large acquiert les propriétés d’un étang. Ce bassin devient un lieu propice aux sports nautiques et un microcosme pour de nombreuses espèces.

Barrage de Jons | Au début des années 1900, on se rend très vite compte que l’eau du Rhône emprunte beaucoup plus largement l’itinéraire du canal de Miribel délaissant celui de Jonage. La pointe « musoir » destinée à diviser le courant entre le Canal de Miribel et de Jonage ne suffit pas à assurer l’entrée d’un débit suffisant au sein de ce dernier. C’est la conséquence d’un phénomène appelé « basculement ».
Dans les années 1920, à plusieurs reprises, le canal n’arrive même pas à emprunter le débit minimum autorisé ; la centrale hydroélectrique de Cusset voit sa production durablement diminuer. La construction d’un barrage à Jons va permettre de résoudre ce problème. Le chantier débute en 1933 et s’achève en 1937. Situé à 100 mètres à l’aval du musoir, le barrage de Jons est composé de cinq ouvertures de dix-sept mètres de large. Chacune est équipée de grandes vannes levantes manœuvrées par des treuils électriques installés dans le pont couvert supérieur.
Les architectes Robert Giroud et Antonin Chomel bénéficient d’une grande liberté dans la conception artistique de l’ouvrage. Ils parviennent à allier rationalité et esthétique. La tour est érigée en rive gauche pour des raisons purement décoratives afin de jouer sur l’effet miroir de l’eau.
Usine barrage de Cusset | D’une puissance de 7 000 KW l’usine, au début du XXème siècle, est la plus puissante de France et l’une des plus puissantes du monde. Le premier quartier desservi par la Société Lyonnaise de Forces Motrices du Rhône fut le quartier de la Croix Rousse et permit aux derniers canuts d’acquérir des moteurs électriques. Au-delà des nombreux ateliers ainsi équipés, l’électricité hydraulique abondante et bon marché permet le développement des secteurs les plus dynamique et novateur de la grande industrie lyonnaise (métallurgie, mécanique, transports, chimie) à l’image du constructeur automobile Berliet.
Selon la loi du 8 avril 1946 qui nationalise l’électricité et le gaz, l’exploitation de la centrale est transférée à EDF. En 2002, la concession est renouvelée à EDF pour 40 ans. Le contrat s’accompagne d’un important programme de rénovation et d’amélioration de l’ensemble des équipements et de plusieurs actions d’accompagnement du territoire comme la participation financière à la création de l’anneau bleu oi encore le désenvasement du Grand Large. En 2008, l’aménagement est entièrement automatisé. L’association Usine Sans Fin et EDF œuvrent ensemble à mettre en valeur et faire connaître ce patrimoine qui allie histoire et modernité. La centrale produit effectivement encore et toujours l’équivalent de la consommation domestique de la ville de Villeurbanne.
L’architecte de l’usine de Cusset est Albert Tournaire. Formé à l’école des Beaux-Arts de Paris, Grand Prix de Rome en 1888, c’est un proche des investisseurs parisiens. C’est pour cette raison qu’il fut choisi, éclipsant l’architecte lyonnais reconnu Roux-Meulien. Imposante et impressionnante par sa masse, surtout à l’aval où la façade regarde la ville, l’usine se compose de deux ailes presque symétriques séparées par un pavillon central qui correspond à un élargissement de la salle des machines. La qualité de cette réalisation renvoie à l’image de puissance et de solidité que la SLFMR veut donner d’elle.
L’architecture de l’usine fait s’accorder exigences fonctionnelles et esthétiques. Riche d’un décor raffiné, la façade aval, de style néoclassique, parée de pierres artificielles, présente un intérêt tout particulier. Le fronton de la façade sud reçoit lui un décor en céramique coloré. Cette dernière possède deux médaillons aux effigies de Joseph-Alphonse Henry (premier président de la SLFMR) et de Jean-François Raclet, ingénieur concepteur du projet. Devenu monument, le bâtiment appartient aujourd’hui au patrimoine régional de la région.
Une usine hydroélectrique comme accompagnatrice du développement industriel du secteur lyonnais
L’activité industrielle concernant les domaines de l’automobile, de la chimie, du textile ou encore la construction électrique connait un essor sans précédent au cours de la première moitié du XXe siècle et l’usine de Cusset semble être un des moteurs de ce développement.
En effet, l’arrivée de cette énergie électrique renouvelable dessine un nouveau mouvement industriel. Le domaine de l’industrie automobile, par exemple, participe à cette dynamique. On observe que la SLFMR n’a pas elle-même initié cette réussite industrielle mais elle l’a accompagné en fournissant l’énergie nécessaire aux grandes usines : Rochet & Schneider, Berliet, Auto-Buire, Cottin-Desgouttes, etc.
L’énergie de l’usine de Cusset devient un partenaire incontournable pour le monde de l’industrie automobile car les chaînes de production et d’assemblage sont de grandes consommatrices d’énergie. Le secteur de l’automobile ne se limite pas qu’aux grands constructeurs, il comprend également les carrossiers, garagistes, mécaniciens ou encore fabricant de pneumatiques. Chacun de ces corps de métier se fournient en énergie auprès de Jonage. Il est clairement observable qu’une corrélation entre l’activité de production de l’énergie électrique et l’essor des entreprises consacrées à l’automobile existe.
Le secteur de la chimie s’appuie lui-aussi sur l’énergie de Jonage. De 1895 à 1914, le secteur chimique regroupe 32 sociétés nouvelles ou parfois simplement renouvelées qui relevent à la fois d’activités traditionnelles comme la teinture et la chimie minérale et d’innovations industrielles. La plupart de ces entreprises (Gillet, Coignet & Cie, Vuillod Ancel entre autres) s’approvisionnent en énergie à Cusset.
L’usine hydroélectrique a initié le changement et l’a accompagné dans son développement. Jonage participe à la création d’une nouvelle civilisation urbaine.
Lyon et sa révolution industrielle : de la Croix-Rousse aux industries de l'est lyonnais
La Fabrique lyonnaise au XIXe siècle : apogée, déclin et réinvention
Les trois premiers quart du XIXe siècle : la Grande Fabrique textile au sommet
Soyeux et Canuts s’installent à la Croix-Rousse | Les tisseurs, jusque-là, sont installés dans le Vieux-Lyon et dans la presqu’île, où ils manquent d’espace et de lumière. Dès 1812 commence la construction du quartier de la Croix Rousse, nouveau quartier, bien caractéristique, destiné à recevoir les ateliers de tissage.
Il offre beaucoup d’avantages : la Croix Rousse est proche du quartier des Terreaux, où travaille la plupart des marchands-fabricants ; le quartier dispose de terrains vierges, aux mains d’une bourgeoisie qui a tiré profit de la Révolution ; la colline dispose d’un air réputé pur ; les impôts y sont presque inexistants (pas d’octroi) car l’espace ne fait pas encore partie de la ville de Lyon. L’architecture est fonctionnelle et robuste, avec de grandes fenêtres (pour la lumière) et un vaste espace sous plafond (quatre mètres de hauteur en moyenne), afin d’y installer les métiers à tisser.
Les canuts, travailleurs/ouvriers à domicile fabriquent le tissu puis le rapportent au donneur d’ordre qui le vend. Payés à façon, ils ne reçoivent pas de salaire et ne sont responsables ni de l’approvisionnement ni de la vente du tissu. Ils sont propriétaires de leur matériel et souvent de leur maison. Ce ne sont pas des prolétaires, ils ont un niveau social plus élevé que l’ouvrier d’usine et sont plus éduqués.
Le développement et le déplacement de l’activité canuse est un des faits majeurs de la période. La soierie demeure une activité de type artisanal et l’atelier du canut est aussi son logement. Deux éléments expliquent l’apparition de nouvelles implantations dans des locaux neufs spécialement conçus pour ce type de production : l’utilisation du nouveau métier Jacquard dont les dimensions imposent des pièces de grande hauteur sous plafond (3,80 m), des plafonds à la française pour permettre l’accrochage du métier aux poutres ; la recherche de l’éclairement qu’il est nécessaire d’avoir, c’est-à-dire plus de lumière que peuvent en procurer les quartiers bas traditionnels.
Les canuts sont donc dans l’obligation de rechercher de nouveaux espaces aptes à recevoir des constructions répondant à leurs besoins impératifs ; les choix se portent en majorité sur les pentes et les plateaux de la Croix-Rousse qui bénéficient dit−on d’un air pur et d’un soleil éclatant mais il y aura des métiers dans toutes les périphéries à la Guillotière, à Vaise et à Saint-Just.
En moins de deux décennies (1822−1840), deux secteurs peu urbanisés des pentes et du plateau de la Croix−Rousse sont colonisés par « ces immeubles canuts » aux hautes fenêtres et aux façades sans ornements implantées le long des voies existantes (le réseau de voirie n’est pas modifié) et dans de mini−lotissements. La densité des maisons très hautes dominant des rues très étroites explique largement le recours aux passages traversant les immeubles : les traboules.

Une activité à son paroxysme | De 1815 à 1880 la croissance annuelle de la soierie lyonnaise oscille autour de 4%. Il s’agit d’un fait remarquable quand on sait que la croissance industrielle française entre 1815 et 1914 ne dépasse pas 1.61%. La croissance du nombre des métiers fut également ininterrompue.
En effet, en 1815, 18 000 métiers battent pour la Fabrique contre 105 000 en 1876. Cette activité textile est partagée entre la ville et la campagne. En effet, les campagnes produisent de grandes quantités de soieries unies et mélangées quand Lyon garde la fabrication des produits les plus élaborés et les plus coûteux. Les finitions, l’organisation financière et surtout le contrôle des liaisons commerciales sont contrôlés par Lyon ce qui permet à la Fabrique d’assurer son bon fonctionnement.
Pourquoi cette distinction de production entre la ville et la campagne ? La croissance de la demande en tissu entraine une forte demande de main-d’œuvre. Ce fait, mêlé à une hausse de la demande des tissus unis dont le tissage demande des travailleurs moins spécialisés amènent les investisseurs à ruraliser la production. De ce fait, les investisseurs peuvent s’appuyer sur une main d’œuvre moins onéreuse qu’en ville car moins qualifiée.
Au cœur du siècle, la soierie lyonnaise est alors rayonnante. Elle fabrique de tout, vend partout dans le monde et s’impose dans les concours internationaux. Durant le Second Empire, elle est l’industrie exportatrice la plus importante de France. Cette prospérité est le résultat de la conjonction de trois facteurs : des marchands-fabricants qui investissent largement et s’engagent sur des marchés toujours nouveaux ; une masse de tisseurs indépendants, dotés pour l’élite d’entre eux d’un grand savoir-faire ; et un secteur artistique et scientifique permettant une innovation permanente.
La prospérité de la Fabrique est sans nul doute le noyau central de la richesse et du dynamisme de la ville de Lyon jusqu’aux années 1880. Le textile occupait et enrichissait le groupe le plus important d’entrepreneurs lyonnais : les marchands de soie. Ces derniers possèdent des capitaux considérables grâce, notamment, au quadruplement de la production du tissage de la soie dans la première partie du XIXe siècle. Ce sont ces entreprises qui sont, à la fin du siècle, responsables du développement industriel notamment dans les domaines de la chimie et de la mécanique.
La Fabrique et le temps de l'usine
Une succession de crises | La Fabrique va connaître, à partir de la seconde partie du XIXe siècle, plusieurs crises qui l’amèneront petit à petit à se transformer et à conquérir de nouveaux marchés. D’abord, dès les années 1850, la sériciculture connaît une grave crise.
En effet, une maladie, la pébrine, ravage les fermes de fer à soie et on estime, en 1854, que quatre cinquièmes des magnaneries des pays du Rhône sont touchées. En 1853, 2 100 tonnes de soie grège sont produites dans le secteur, en comparaison, seulement 600 tonnes sortiront des élevages l’année suivante. En 1870, des graines saines sont importées du Japon pour relancer la culture du ver à soie.
Cette aide précieuse n’empêche pas que la sériciculture française ne retrouvera jamais son rendement antérieur à l’épizootie. Malgré cette catastrophe sans précédent, les soyeux lyonnais ont su très vite mobiliser les autres marchés d’approvisionnement à leur profit comme ceux du Piémont, de Lombardie, de Naples ou encore de Grèce.
Le secteur est certes fragilisé mais l’expérience et le savoir-faire des soyeux permettent à Lyon de subtiliser à Londres la première place pour le marché mondial des soies et d’éviter un effondrement de la production. A partir de 1873, le monde subit un ralentissement économique que l’on a appelé “Grande Dépression” ou “Grande déflation”. Le monde de la soie lyonnais est durement touché, notamment à la suite du krach de l’un de ses principaux organismes bancaires : l’Union générale.
Les exportations de soieries unies s’effondrent, en valeur, de moitié. La crise de la Fabrique n’est pas seulement conjoncturelle, elle s’explique aussi par un changement de goût : la mode est plus capricieuse que jamais. Les lourdes étoffes de soie pure sont délaissées pour laisser la place aux “nouveautés” : crêpes, gazes, mousselines, etc.
La clientèle change ses habitudes de consommation certes par goût mais aussi par nécessité financière. On mélange la soie avec de la laine et du coton et on a recours à des soies de qualité médiocre comme les “tussahs” asiatiques. La Fabrique semble tant bien que mal surmonter cette crise en substituant aux “façonnés” et aux belles “unies” les taffetas, les foulards, les satins ou encore les crêpes.
Malgré cette capacité impressionnante d’adaptation, la Fabrique doit se tourner vers une nouvelle voie, se réinventer pour ne pas disparaître.
La Fabrique se transforme et s’industrialise à l’est | La trilogie de la mutation de la Fabrique (de nouvelles fibres, la mécanisation des tissages et la teinture en pièces) était déjà inscrite lors des crises subies par le secteur mais encore très discrète.
En effet, dans les années 1850, on ne compte pas plus d’une douzaine d’usines dans toute la région soyeuse. On peut citer l’usine de Claude-Joseph Bonnet à Jujurieux ou celle de J.-B Martin à Tarare qui font figure d’exemple. Il faut attendre la fin du siècle pour qu’elle se concrétise poussée par les impératifs du marché. Dans le secteur textile, on observe en 1877 un développement décisif des usines et des métiers mécaniques. Les métiers à bras et le travail à domicile se raréfie et de nombreuses entreprises de marchands-fabricants disparaissent.
Cette période est marquée par le développement de la chimie à Lyon, en lien direct avec l’activité soyeuse. La production de teintures, jusqu’alors très artisanale et concentrée à Lyon et Caluire, bénéficie des découvertes des chimistes en matière de colorants synthétiques. Elle va assurer le développement, puis la fortune de quelques grandes maisons, comme celle de François Gillet, spécialisée dans la teinture des soies noires sur lequel nous reviendront ensuite.
C’est aussi à cette époque que se dessine l’extension de l’agglomération lyonnaise vers l’Est. Les premiers établissements de teinture, localisés jusque-là sur la Saône ou le Rhône (quartier de Saint-Clair notamment), migrent en direction des Brotteaux, de Montplaisir et de Villeurbanne, plus particulièrement le long de la Rize. Cette rivière va jouer un rôle essentiel dans la première vague d’industrialisation de l’Est lyonnais et dans la prospérité de Villeurbanne.
Les grandes usines qui s’installent sont à la recherche de plus d’espace mais aussi d’eaux plus douces que celles des fleuves ou de la nappe phréatique : celles de la Rize donnent des teintures de meilleure qualité. En 1874, Renard et Villet (teinturiers) installent à la Cité à Villeurbanne une grande usine dotée de laboratoires et d’ateliers de production chimique. Ils emploient 800 ouvriers. Bonnet (avec 650 ouvriers), et Ramel-Marnas s’installent route de Vaulx.
La Rize, enserrée par les usines, est vite condamnée à l’insalubrité. En 1895, une entreprise qui a pour figure le chimiste Prosper Monnet, devient une Société Anonyme sous le nom de « Société chimique des usines du Rhône » principalement établit à Saint-Fons. Cette entreprise dépose en 1898 le brevet de l’indigo synthétique. En 1928, par fusion avec les Etablissements Poulenc Frères, la société devient celle des usines chimiques Rhône-Poulenc.
Cette société chimique a de très anciennes racines à Lyon : à ses origines, l’entreprise est une maison de commerce de produits tinctoriaux créée sous le premier empire et remplacée en 1868 par la société Gilliard et Monnet.
Ecole, banque et transport : des révolutions au service de l'industrie
Accélération des échanges par le transport ferroviaire
La première moitié du XIXe siècle voit se créer progressivement les conditions de la Révolution industrielle lyonnaise et le développement des transports navals et ferroviaire en sont de bons exemples.
Entre 1826 et 1832 des capitaux, essentiellement parisiens, réalisent la liaison ferroviaire Lyon-Saint-Etienne presque exclusivement dédiée au transport des marchandises, plus particulièrement du charbon. Cette ligne célèbre est empruntée par la non moins célèbre locomotive à chaudière tubulaire de Marc Seguin. Le bassin houiller stéphanois est le plus important de France dans la première partie du XIXe siècle.
La question du transport de la houille stéphanoise vers la vallée du Rhône se pose d’autant plus que les propriétaires à perpétuité du canal de Givors -par lequel passe la plupart des marchandises- pratiquent un tarif élevé. Au surplus, le canal n’est pas utilisable toute l’année (gel en hiver, chômage en été par insuffisance d’alimentation en eau, entretien des écluses…).
Par ailleurs, la route de Saint-Étienne à Lyon est trop dégradée pour pouvoir supporter un trafic plus intense. La nouvelle ligne reliant Lyon à Saint-Etienne permet de s’affranchir de ces difficultés et concourt au développement industriel des deux villes en accélérant et facilitant considérablement les échanges.
Le 23 octobre 1881, la Société anonyme du Chemin de fer de l’est de Lyon (CFEL) inaugure une ligne ferroviaire longue de 72 kilomètres comportant 21 gares et reliant Lyon (gare de l’Est) à Saint-Génix-d’Aoste. Cette ligne, financée en grande partie par des industriels de la région, a elle aussi pour but le transport de marchandises.
Le trafic est principalement généré par l’activité agricole de la plaine de l’est lyonnais, par les matériaux extraits des carrières de pierre ainsi que par les industries métallurgiques ou chimiques implantées dans le secteur de Décines, Meyzieu et Pont-de-Chéruy.

Banques et banquiers comme accompagnants de la prospérité
Au milieu du XIXe siècle, on dénombre une vingtaine de banquier sur la place de Lyon. Leur essor s’explique par l’industrialisation progressive de Lyon ; ils accompagnent et servent la prospérité lyonnaise. Ils ouvrent des crédits à court terme, accordent des prêts plus longs ou encore souscrivent au capital des nouvelles sociétés anonymes.
Nombreuses sont les tentatives de création de nouvelles formes bancaire dans la première partie du siècle. Par exemple, en 1835, est fondée la Banque de Lyon par les principaux négociants et marchands de soie de la ville. En 1848, elle devient succursale de la Banque de France.
Dans les années 1860, la banque moderne largement ouverte à tous les publics par une système de guichets et de succursales multiples, apparait à Lyon et en France. Elle utilise la nouvelle législation libérant les société anonymes et draine les capitaux excédentaires accumulés pendant la plus forte période de prospérité économique.
Cette nouvelle banque est donc la conséquence et non la cause de l’essor industriel, tout en développant et accompagnant les nouvelles formes d’industrie.
Les fabriques à ingénieur
Pendant longtemps, les besoins en technicien et ingénieur furent assez limités. Avec l’industrialisation de Lyon au XIXe siècle, le secteur privé prend l’initiative de créer un système d’enseignement professionnel qui s’adapte aux besoins spécifiques de la région.
Le 13 septembre 1800, meurt le major-général Claude Martin. Soldat français de la Compagnie française des Indes orientales, puis de la Compagnie anglaise des Indes orientales, il amasse une fortune colossale, probablement la plus grande d’un européen sur le territoire indien. Il décide de léguer ses biens à la construction de trois écoles portant toutes le nom de « La Martinière ».
Deux sont construites en Inde et une à Lyon. L’école lyonnaise prend place au sein de l’ancien couvent des Augustins, elle est officiellement inaugurée le 2 décembre 1833. Elle forme alors des ingénieurs qui participent au développement industriel du secteur. Certains de ses élèves accèdent au rang d’entrepreneurs comme les chimistes Coignet, Perret ou encore Guinon. Malgré la création de cette « fabrique » à ingénieur, la région lyonnaise continue à cruellement manquer de technicien.
En 1857, à l’initiative d’un marchand de soie et saint-simonien nommé Arlès-Dufour et grâce au financement de divers industriels lyonnais, l’Ecole centrale lyonnaise est créée. L’école fonctionne tout d’abord avec des effectifs restreints (dix à vingt élèves par année), recrutés à Lyon et dans la région, très souvent eux-mêmes fils d’industriels. Les nouveaux formés sont ensuite employés pour plus de la moitié dans des industries régionales.
C’est ensuite la Chambre de commerce qui crée en 1872 l’Ecole de commerce grâce à un financement du patronat du textile.
La bourgeoisie lyonnaise a la volonté d’améliorer la qualité professionnelle des travailleurs. En effet, en 1864, des hommes comme Arlès-Dufour, H.Germain ou encore F.Mangini – associés à plusieurs groupes d’artisans – créent l’Association lyonnaise pour la propagation de l’enseignement qui deviendra ensuite la Société d’enseignement professionnelle du Rhône. Son fonctionnement est original : les enseignements étaient ouverts à la demande des élèves, décentralisés, aussi près que possible des lieux de travail et répartis en cours primaires, des cours professionnels généraux et spécialisés.
Grâce à ces écoles, les industriels de la région s’assurent un turn-over efficace de leur entreprise et voient s’accroître les potentialités d’innovation et de développement.

Les Gillet et le développement de la chimie à Lyon et dans l'est lyonnais
François Gillet : la teinture comme socle d'un developpement exponentiel
D’une exploitation paysanne à la teinture lyonnaise | François Gillet est né le 10 décembre 1813 à Bully dans les monts du Lyonnais.
Aîné de trois enfants de parents paysans, il décide de ne pas reprendre l’exploitation familiale et commence un apprentissage de tisseur dans son village natal. En 1830, un cousin éloigné lui offre une place d’apprenti teinturier à Lyon, rue des Trois-Maries, dans le quartier Saint-Jean. En 1833, François Gillet décide de quitter son cousin et se fait engager à « La grande maison de teinture du temps » tenue par Michel Frères, spécialisée dans la teinture noire, dans le quartier Saint-Georges.
En 1838, il demeure rue Saint-Georges et s’associe avec un autre ouvrier teinturier, Alexandre Bertrand, pour établir et exploiter une teinturerie rue Molière aux Brotteaux. François Gillet se marie en 1840 à Marie Pierron, troisième d’une famille bourgeoise de treize enfants. Fin d’année 1840, une crue du Rhône ravage son atelier. Le couple déménage à Guillotière et Monsieur Gillet installe son atelier à proximité de son domicile. Il emploie quatre ouvriers en 1842.
Décembre 1845, François Gillet est déclaré teinturier installé sur la rive droite de la Saône, 124 quai Pierre Scize, à l’occasion d’une première acquisition foncière faite en commun avec son beau-frère François Pierron. En 1847, les deux François s’associent pour dix ans sous la raison sociale Gillet & Pierron. L’affaire tourne très bien et leur emplacement quai Pierre Scize, entouré de maison, les empêche de pouvoir agrandir leur atelier.
Il décide de déménager en 1852 à la Croix-Rousse au 7 quai de Serin. L’entreprise fonctionne très bien : hommes et matériels grossissent les rangs de la production. Selon une brochure historique datant de 1878 vantant les mérites de l’entreprise, cent cinquante ouvriers travaillent dans l’usine en 1854.
En 1862, la société Gillet & Pierron est dissoute, la liquidation est effectuée par François Gillet qui continue seul son activité. Toujours selon la brochure historique de 1878, l’entreprise passerait de trois cent cinquante salariés en 1862 à quatre cent cinquante en 1867 avec un chiffre d’affaires annuel de 3 millions de francs.

La teinture noire et la fortune de François Gillet |La teinturerie lyonnaise, après avoir dominé l’Europe, n’est pas très en vue au début du XIXe siècle. Il faut attendre la seconde partie du siècle pour voir une maison lyonnaise (Guinon, à la Guillotière) distinguée à l’échelle nationale par une médaille d’or pour son savoir-faire. Il s’agit là d’un teinturier en couleur. La teinture au noir était quant à elle une activité à part dans la mesure où il n’existait aucune matière colorante naturellement noire qui puisse être utilisée.
On pouvait obtenir du noir en réunissant plusieurs couleurs différentes ou choisir le procédé traditionnel venu de Chine, celui du noir à la noix de galle mais, dans les deux cas, le résultat était grisâtre et ne tenait pas dans le temps. La demande en teinture noire, jusque-là très disparate, augmente significativement à partir des années 1810-1820 grâce à l’amélioration de son procédé de fabrication. François Gillet profite de ces progrès lorsqu’il s’installe à son compte en 1838.
François Gillet a tiré son épingle du jeu face à ses concurrents en faisant preuve d’une grande habilité technique : la technique de teinture au noir est difficile à réaliser et très souvent, la soie avait tendance à se détériorer et des tâches pouvaient apparaître. C’est en se rendant maître de ses difficultés qu’il s’établit une solide réputation.
En 1854, du henné, importé d’Algérie, est appliqué à une très large échelle à la teinture au noir. François Gillet prend un brevet pour cette découverte. Le henné permet de produire un noir très intense et solide qui eut beaucoup de succès pendant environ six ans. La mode changea ensuite pour des teintes plus bleutées.
La force de l’entreprise Gillet repose sur son savoir-faire mais également sur sa longévité, là où ses concurrents ont tendance à disparaître pour diverses raisons, la maison Gillet tient dans la continuité. Cette constance permet au teinturier d’étendre ses possessions foncières et sa production : immeuble quai de Serin et usine de Saint-Chamond dans la Loire. En 1869, ce développement débouche sur la transformation de l’entreprise personnelle en une nouvelle société collective, associant cette fois-ci le fils ainé Joseph, alors âgé de 26 ans.
Diversification de la production et installation à l'est
Les Gillet à la conquête du textile artificiel | La Société Gillet & Fils, qui fête en 1888 le cinquantenaire de l’entreprise créée par François Gillet, va exploiter au mieux toutes ces innovations. À la fin des années 1880, la firme possède de nombreuses usines en France et à l’étranger (Russie, Autriche, Amérique, Italie) et François Gillet est déjà à la tête d’une très grosse fortune (plus de 100 millions de francs de l’époque).
Il a contribué avec d’autres membres du patronat social lyonnais (Mangini, Aynard…) à la fondation en 1886 de la SA des Logements Economiques (qui précède la création nationale des HBM), pour encourager la création de « cités ouvrières » à proximité des usines de Lyon et Villeurbanne.
En 1890, la firme Gillet & fils crée deux grandes usines à Villeurbanne, pour la teinture et l’apprêt (rues Flachet et des Glacières). Ce seront pendant longtemps les plus importantes usines de la commune (1500 ouvriers). La firme construit également à Villeurbanne les années suivantes, par l’intermédiaire de la SA des Logements Economiques, des immeubles collectifs sur 4 niveaux (rue Koechlin) pour ses ouvriers et ceux des usines alentours. Disposant d’un confort appréciable pour l’époque, ces immeubles constituent le premier ensemble de logements sociaux important de Villeurbanne. En 1892, la société Gillet & Fils déplace son siège de Lyon à Villeurbanne.
Lorsque François Gillet meurt en 1895, il dispose d’une fortune immense et d’une réputation mondiale. « Lyon est en deuil » peut-on lire dans certains journaux. Le groupe Gillet, repris par ses fils, exploite très vite le nouveau procédé de production de soie artificielle.
L’arrivée aux commandes de la deuxième génération Gillet a coïncidé avec un enrichissement considérable de l’affaire familiale. L’entreprise, à la fin du XIXe siècle, est leader incontestée de la branche teinture à Lyon. Elle s’étend vers la teinture couleur et intègre d’autres activités du traitement textile : blanchiment, gaufrage, moirage et impression. Elle se tourne vers de nouvelles matières telles que le coton et le textile artificiel. Les bénéfices explosent, les implantations se multiplient et les effectifs gonflent.
C’est à partir de 1902 que les Gillet investissent dans une nouvelle industrie : la filature de de soie artificielle. Le textile artificiel permet aux Gillet de faire concurrence aux sériciculteurs en mettant sur le marché un produit abordable. Cette production donne la possibilité aux fabricants tisseurs de sortir du marché du luxe de la soie pour s’orienter vers la consommation de masse.
En 1911, la concurrence entre l’entreprise Carnot (productrice de textile artificielle) et les Gillet cesse avec la formation à Paris d’un bureau de vente commun : le Comptoir du Textile Artificiel (CTA). Après la guerre de 14-18, l’ensemble industriel du CTA se développe considérablement. En 1922, le CTA décide de la construction de l’usine de la « Soie artificielle du Sud-Est » à Vaulx-en-Velin, projet d’usine de viscose le plus ambitieux de France.
Qu’est-ce que le textile artificiel ? | Le comte Hilaire de Chardonnet, première personne à avoir déposé un brevet lié à la fabrication du textile artificiel. Né en 1839 et mort en 1924, cet ingénieur à l’orientation politique monarchiste, officie comme Chambellan à la cour du Comte de Chambord à Frohsdorf.
Il faut attendre 1883 et ses désillusions politiques pour qu’il s’implique entièrement à la recherche scientifique. Alors qu’il connaît déjà très bien la maladie qui touche les vers à soie (pébrine) et ses conséquences économiques, il cherche à fabriquer un textile artificiel qu’il pourrait mettre sur le marché pour palier à la baisse de la production de soie naturelle. De plus, la France, en pleine révolution industrielle, voit se créer une classe moyenne à même de pouvoir s’offrir des tissus bon marché.
Il dépose son brevet en 1884 et fonde en 1890, à Besançon, la Société anonyme pour la fabrication de la soie de Chardonet. La société connaît de lourdes pertes à cause du coût trop élevé du procédé de fabrication du textile artificiel. Des concurrents allemand et anglais améliorent rapidement le processus de fabrication rendant la formule de Chardonnet obsolète. Le 12 mai 1919, il est élu membre de l’Académie des sciences, dans la section des applications de la science à l’industrie. Il meurt à Paris à l’âge de 85 ans, le 11 mars 1924.
C’est à partir de 1855 que l’on s’intéresse à la cellulose pour fabriquer un fil analogue produit par le ver à soie. C’est en 1884 que le comte Hilaire de Chardonnet (1839-1924) a déposé le premier brevet pour une fabrication industrielle du textile artificiel à base de cellulose. Le procédé consiste à utiliser de la nitrocellulose, de l’éther et de l’alcool. Ce dernier s’avère trop coûteux pour une application industrielle à long terme et il est rapidement abandonné.
C’est finalement un procédé britannique qui fera le plus ses preuves. On tire cette fois la cellulose du bois avec une dissolution successive à la soude et au sulfure de carbone. On obtient ensuite du xanthate de cellulose, plus communément appelée « viscose. » C’est selon le procédé anglais que la viscose fut produite pendant cinquante ans au sein de l’usine TASE. Trois types de fils ont été produits : la Fibranne, la Rayonne et le fil industriel.